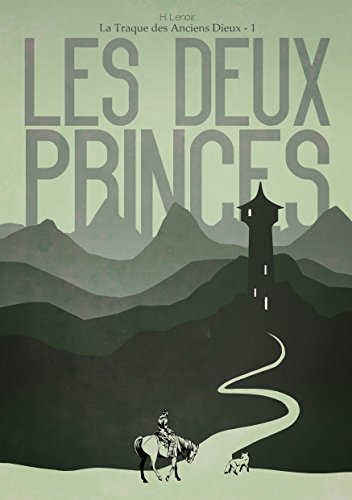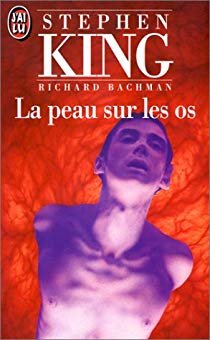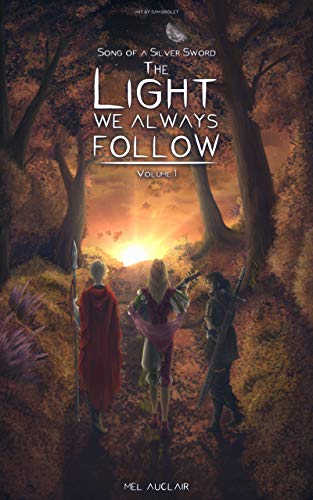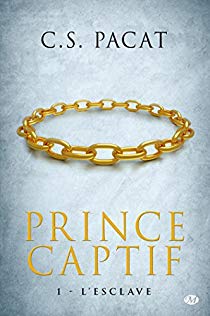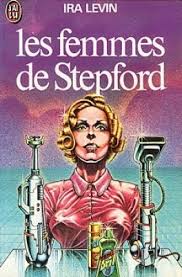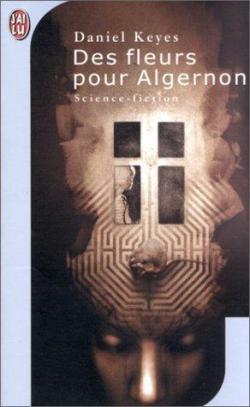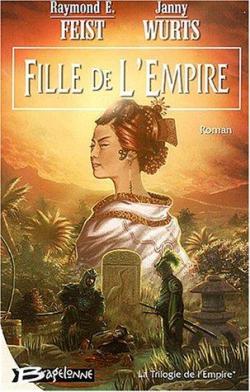
Critique n°11 : La Trilogie de l’Empire, Tome 1 : Fille de l’Empire, Raymond E. Feist et Janny Wurts
« Dame, que pensez-vous qu’est le Jeu, si ce n’est rester en vie tout en se débarrassant de ses ennemis ? »
-Seigneur de guerre Almecho
On m’avait conseillé ce livre il y a déjà plus d’un mois déjà. Mais comme j’avais lu beaucoup de fantasy à la suite, j’avais décidé de reporter un peu la lecture de ce tome. On m’avait bien précisé, cependant, qu’il faisait partie d’une saga bien plus vaste, les Chroniques de Krondor ; mais que cette Trilogie de l’Empire mettait l’accent sur une autre région. J’ai appris par la suite que parfois, apparemment, certains événements de la trilogie de l’Empire pouvaient être concomitants de ce qu’il se passe dans d’autres volumes des Chroniques.
A l’origine destinée à rejoindre les ordres, Mara, une jeune fille noble, se retrouve propulsée à la tête de sa famille, les Acoma, à la suite de la mort de son père et de son frère. Seulement, l’assassin de sa famille, Jingu Minwanabi, a bien l’intention de faire disparaître les Acoma. La jeune fille doit donc apprendre à composer avec son nouveau rôle au plus vite – tout en protégeant sa famille.
Je ne le cache pas, j’ai tout de suite pensé au personnage de Daenerys Targaryen en commençant à lire : au départ jeune noble inexpérimentée, elle apprend ce que diriger une famille signifie, tout en apprenant les arcanes de la politique. Là s’arrête la ressemblance. Mara est certes entourée de sa nourrice qui devient son premier conseiller, ainsi que de deux soldats fiables, mais elle reste une toute jeune fille dans un monde dirigé par les jeux de pouvoir. Elle ne peut compter que sur elle-même et son intelligence, alors qu’elle a manqué plusieurs années d’éducation politique. Et cela marche. Elle a tendance à réfléchir hors des sentiers battus, prenant des options parfois audacieuses – qui fonctionnent.-, avec des interprétations personnelles et nouvelles des traditions Tsuruannis. Mais les idéaux de pureté morale ne tiennent pas longtemps dans ce monde : progressivement, Mara se doit de devenir impitoyable, de ne pas montrer la moindre preuve de faiblesse. Alors même que parfois, elle éprouve des remords et des regrets. Et en cela je salue tout le développement de son personnage. On ne peut qu’admirer le dévouement de Mara envers son clan, qui la conduit à se mettre parfois dans des situations forts délicates, où elle ne peut parfois que disposer ses pions..et d’attendre.
Je peux noter également l’univers, assez étonnant pour un roman de fantasy. Là où beaucoup de romans fantasy sont dans un cadre plutôt européen, l’Empire où réside Mara est très clairement inspiré du Japon féodal : certains noms qui ne détonneraient pas au Japon tels les Anasati ou les Minwanabi, le Seigneur de guerre qui rappelle le Shogun, le système de clans, les guerriers gris rappelant les rônins, ainsi que certaines traditions comme le suicide. Mais ce n’est pas un simple copier-coller du Japon ; l’Empire a ses propres particularités, souvent évoquées via la manière dont Mara les contourne et les utilise au contraire à son avantage.Mais à la fin du roman, on sent qu’il existe encore bien d’autres éléments dans cet univers, que j’ai eu progressivement hâte de découvrir, notamment les guerriers cho-ja.
Passons enfin aux personnages. J’ai déjà évoqué le personnage de Mara, qui loin d’être caricatural est bien campé et intéressant, dont on voit l’évolution. Il est facile de s’attacher à plusieurs de ses proches, notamment Nacoya et Lujan. Si ses ennemis sont bien campés, j’aurais apprécié parfois avoir un peu plus de nuances dans leurs personnalités, et qu’on aille plus loin dans leur opinion de Mara que « la chienne Acoma. » (Je ne ferais pas de commentaire sur l’insulte, mais en lisant cela, j’ai levé les yeux au ciel.) On comprend que pour eux, Mara est un ennemi, mais j’aurais aimé en savoir plus sur leurs motivations personnelles au-delà d’une simple querelle de famille.
Cependant, il y a une chose que j’ai appréciée : je n’ai eu que très rarement l’impression de lire une scène vraiment inutile. Qu’il s’agisse de scènes de vie quotidienne chez les Acoma ou d’intrigues politiques, chaque passage a son importance. Je peux juste regretter la façon dont certaines scènes se passent (notamment le passage citer dans le paragraphe au-dessus), mais pas leur nature. J’ai de plus apprécié la tension du premier chapitre, même si l’on sait que quelque chose va se passer. On retrouve de plus certains effets de parallèle assez intéressants entre le début et la fin du roman, qui montrent bien comment les personnages ont évolué entre temps.
Au final, ce livre a été une lecture assez plaisante – une fois de plus sans être un coup de cœur-, je lui donne donc un 8,5/10. L’univers est différent, l’intrigue intéressante et bien traitée, avec plusieurs personnages que l’on apprend à apprécier. Il a des défauts, c’est certain, mais rien qui puisse vraiment empêcher la lecture. J’ai donc hâte de lire le second tome !